Document préparé par Caroline Martin, sous la direction de Antoine Olavarrieta, Françoise Reynaud et François Vergès, AdP c/o ISTED – Villes en développement.
A travers une enquête auprès de quelques-unes des personnalités exerçant dans le milieu de la coopération urbaine (membres d’ONG, chercheurs, responsables de formation, bureaux d’études, consultants, fonctionnaires et étudiants), les enjeux de l’évolution de ces métiers, examinés lors de la journée de l’AdP ont pu être mesurés. Cette approche a pu être éclairée par des discussions portant essentiellement sur chaque parcours individuel. Il s’avère que cette communauté professionnelle, dont le niveau de compétences est largement reconnu, tend aujourd’hui à s’atomiser, que les grands « projets de développement urbain » qui faisaient appel à une expertise ou une assistance technique nombreuse (avec résidence sur place) se raréfient et que, faute de structure d’encadrement et de suivi, elle perd de l’importance et de l’influence.
Avant de se lancer dans le vif du sujet, il s’agit de comprendre, au regard de l’évolution de la coopération urbaine française, comment les professionnels ont su se positionner dans ce milieu au cours de leur carrière. Par ailleurs, ce regard sur l’histoire d’un milieu professionnel doit s’accompagner de la connaissance des acteurs qui financent et pensent les stratégies. Bailleurs de fonds, acteurs des différentes coopérations, bilatérales, multilatérales, tous dans leurs choix influencent tant l’offre que la demande de ce secteur. Face à cela, la coopération urbaine française semble aujourd’hui déstructurée entre la recherche, les ONG, l’expertise indépendante (BET et experts indépendants) et la coopération décentralisée. En témoigne l’embarras des maîtres d’ouvrage français rencontrés à choisir entre des équipes ad hoc de consultants qui s’associent au gré des appels d’offre et les rares bureaux d’étude français intervenant dans le champ urbain à l’étranger. Mais si elle est déstructurée, elle n’en est pas moins encore importante.
La culture d’une coopération franco-française, longtemps cantonnée au pré carré de la zone de solidarité prioritaire et plus encore à l’Afrique francophone, a sans doute retardé et rendu plus ardue l’ouverture du milieu à d’autres expériences et d’autres savoir-faire.
Il est vrai qu’il existe deux modes d’exercice du métier à l’étranger : d’une part les interventions dans les pays développés ou émergeants qui font l’objet d’une démarche et d’initiatives commerciales relevant de chaque groupe d’intérêt et, d’autre part, l’activité dans les p.e.d. qui fait l’objet de politique et de financements de coopération. Nous ne traiterons ici que de la seconde catégorie.
Rappel de l’évolution de la coopération urbaine
Les premières interventions de la France
La période coloniale qui s’achève au milieu du XXe siècle aura constitué la base de la coopération urbaine française. La période qui a suivi la colonisation est caractérisée par la coopération dite de substitution. Cette démarche laisse une large part aux aspects administratifs, techniques et réglementaires, et est dominée par la notion de service public souvent dans un cadre de prestations subventionnées, parfois gratuites. Le personnel français et africain en poste à l’époque coloniale a été maintenu après les Indépendances. Les fonctionnaires coloniaux sont souvent devenus les assistants techniques et ont poursuivi leurs actions d’administration mais sans plus être à des postes de commandement. Ingénieurs, architectes, urbanistes et techniciens français se sont succédés, participant à la réalisation de Plans d’Urbanisme et des Schémas Directeurs des villes africaines. La France met alors l’accent sur la coopération urbaine afin d’aider ces pays en développement à se doter de villes modernes, à renforcer leurs institutions et à former des équipes de techniciens nationaux pour relayer les coopérants. Par ailleurs, cette période est marquée par l’urgence de la construction de bâtiments publics pour les nouveaux Etats et de logements pour les nouveaux fonctionnaires. Le Fonds Européen de Développement (FED) et la coopération française financent la majeure partie de ces travaux de construction dont les assistants techniques sont en charge. Des financements importants accordés par la France à des sociétés immobilières nationales (organisme d’HLM soutenus par la Caisse des Dépôts et Consignations ou encore par la Caisse Centrale de Coopération Economique, l’actuelle Agence Française de Développement, AFD), vont permettrent d’appuyer cette politique de production de l’habitat et d’envoyer sur le terrain de nombreux architectes et urbanistes. Il s’agit souvent pour eux de diriger ces sociétés immobilières à travers des fonctions d’appui à la production et à la gestion du patrimoine immobilier.
A partir des années 70 la situation évolue visiblement vers un urbanisme opérationnel et planificateur, qu’illustrent des projets de développement planifié des villes et dont la France se fait alors une spécialité. Pour autant, la cohérence technique se désintègre car aucune stratégie politique globale ne vient guider des méthodes et dicter des thématiques d’intervention française.
L’explosion de la ville du Sud et l’urbanisation accélérée prennent de vitesse l’aide planificatrice. Ce phénomène suscite un renouvellement de la réflexion et de la stratégie de la coopération urbaine dont témoigne la préparation de la conférence des Nations Unies Habitat 1, à Vancouver en 1976. La France doit réajuster ses méthodes d’intervention face à l’apparition des bailleurs de fonds internationaux.
L’entrée en scène de la Banque Mondiale
La Banque Mondiale se positionne comme principale instigatrice de ces stratégies en s’imposant par la plus grande capacité de mobilisation de financement et la concentration de 50% des aides bi et multilatérales.
Elle ne reconnaît véritablement l’intérêt du secteur urbain que tard, vers le début des années 70. Progressivement, elle voit dans la croissance urbaine l’avantage d’une concentration de la main d’œuvre. Elle préconise alors des investissements dans les secteurs manufacturés.
Par ailleurs, elle mobilise des fonds pour la mise en place d’une politique d’accès au sol et au logement des populations urbaines. Elle développe des stratégies de l’habitat du plus grand nombre et de lutte contre la pauvreté urbaine pour favoriser la stabilisation des jeunes populations en ville étant donné que les populations solvables sont les principaux instruments du financement du développement. L’action de la Banque Mondiale se concentre pendant cette décennie sur l’aménagement physique des villes Elle instaure les projets sites and services qui consistent à fournir des parcelles et lotissements assainis qu’inaugure la réalisation du premier « projet de développement urbain » à Dakar en 1972.
Les programmes des années 80
Les années 80 seront quant à elles marquées par les politiques d’ajustement structurel. Réformes institutionnelles, économiques et financières se succèdent pour alléger les charges de l’Etat et rendre l’action publique plus efficace. La privatisation de centaines d’entreprises publiques de production et de service annonce l’échec des modèles de développement précédents, dû à l’endettement des pays concernés. Les conséquences sociales et politiques de ces réformes seront souvent dramatiques.
C’est au même moment que la France, poussée par les pratiques des bailleurs multilatéraux, passe de la coopération de substitution à la coopération par projet. Pour autant, le système de coopération par projet a des limites. Un projet contient en lui-même toutes les composantes qui seront financées par l’institution. Ses ressources, ses problématiques, ses procédures, ses méthodes de réalisation, etc. seront définies à l’avance. La Banque Mondiale a instauré pour cela un « bureau de projet » pour exécuter chaque programme. Que cette forme d’intervention soit considérée comme un moyen efficace de faire du développement urbain car elle a des moyens et des objectifs, ou qu’elle soit en revanche perçue comme une juxtaposition d’opérations partielles et limitées, ces agences d’exécution se sont en fait substituées aux systèmes décisionnels locaux provoquant des dérèglements dans le milieu (procédures d’exception, confiscation de l’information, rapt de la compétence, salaires majorés, etc.). Cette expérience de la coopération par projets met une fois de plus en évidence les difficultés rencontrées par la coopération urbaine face à la question cruciale du lien à tisser entre l’appui institutionnel d’une part et le financement des infrastructures d’autre part.
La création de grands programmes mobilisateurs français, comme le PGU (Programme de Gestion Urbaine) initié par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) en 1986, ou encore PS-eau et PS-habitat en 1988 annonce l’ère de l’aide aux collectivités locales. L’émergence des collectivités locales élues conduisant à l’autonomisation progressive des municipalités leur confère de nouvelles responsabilités. La ville devient garante du développement économique des territoires et le soutien aux collectivités facilite les initiatives locales. C’est pourquoi, il faut promouvoir la concertation entre les acteurs dans des domaines comme l’eau et l’habitat et faire prendre conscience du rôle stratégique des collectivités locales en vue du développement durable dans un contexte de décentralisation.
Les réformes françaises des années 90
Dans les années 90, la coopération française va connaître un nouveau tournant. La publication du document « La Coopération française pour le développement urbain », instaure trois principes : 1. Appui à la décentralisation et au renforcement des collectivités locales pour rapprocher les gestionnaires des besoins essentiels aux populations urbaines. 2. Renforcement de l’autonomie de gestion des services publics marchands pour les rendre performants techniquement et économiquement. 3. Production privée de l’habitat en ce qui concerne les terrains à bâtir et le logement pour le plus grand nombre. Dès lors, la coopération urbaine française va suivre ces nouveaux axes stratégiques.
En parallèle, les acteurs se diversifient. L’Etat n’a plus le monopole de l’intervention dans le domaine du développement urbain à l’étranger. L’effectif croissant des collectivités locales et des ONG complexifie la lisibilité de l’action française, particulièrement dans les villes d’Afrique subsaharienne. Ces nouveaux acteurs s’orientent vers les attentes des populations pour une intervention à l’échelle locale.
L’apparition de l’idée de développement local
Hors de la France, les bailleurs de fonds montrent un intérêt grandissant pour le développement local. La Banque Mondiale augmente le volume de ses projets urbains et plaide en faveur de l’amélioration de la productivité, de la lutte contre la pauvreté et de la protection de l’environnement en ville. Dans ce contexte, elle s’intéresse particulièrement aux associations, participant ainsi à leur croissance rapide, au Nord comme au Sud. Par ailleurs, elle s’implique dans la décentralisation et dans le renforcement des collectivités locales. De fait, les différentes coopérations et les autres bailleurs suivent la même stratégie, à l’image du PNUD, qui publie le premier rapport sur le développement humain en 1990, et met en avant le thème de la lutte contre la pauvreté. Les nouvelles stratégies marquent leur intérêt pour la dimension locale du développement (développement municipal, aménagement participatif, coopération décentralisée) ouvrant ainsi ce champ aux nouveaux acteurs urbains et aux ONG.
Les grandes conférences et les nouvelles orientations
Vers le milieu des années 90, la remise en cause du modèle de l’ajustement structurel, dont la régulation des marchés financiers a des effets sociaux négatifs (crises financières des pays asiatiques, puis des pays d’Amérique Latine qui pourtant sont des modèles de développement socio-économique) mobilise les acteurs français du développement urbain autour de la conférence Habitat II qui se tient à Istanbul en 1996 et où les collectivités locales sont largement représentées. Cette réunion capitale ne donne cependant pas de résonance opérationnelle à la coopération urbaine.
Peu de temps après, début 1999, la Banque Mondiale réactualise sa politique en proposant une vision plus globale du développement. Elle renforce ses liens avec le FMI en même temps qu’elle harmonise leurs actions et fait bénéficier l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) de son soutien car cette stratégie tend vers un modèle de développement libéral. Dans le même temps, elle prépare les conditions préalables à la mise en place d’une économie de marché mondiale : elle plaide pour un gouvernement compétent et intègre un système financier organisé et bien contrôlé, un programme social : la « bonne gouvernance ». Par ailleurs, elle applique deux stratégies différentes pour le domaine urbain et le rural. Comme elle considère maintenant la ville comme un facteur de développement, elle oriente son soutien et son intérêt pour le secteur privé des mégapoles afin de créer les conditions structurelles propices à l’investissement. En mai 1999, la publication du document « Strategic view of urban and local government » fixe un cadre à ces orientations et énonce des objectifs d’intégration du secteur privé dans le domaine du développement urbain. Les conditions pour que les villes participent à leur développement économique et améliorent ainsi les conditions de vie des habitants sont au nombre de quatre : amplifier la compétitivité des villes, accroître la qualité de vie en ville, reposer l’amélioration des ressources et de leur gestion sur une bonne gouvernance et, privilégier une gestion privée des services en s’assurant de la bancability des villes qui doivent prouver leur sérieux en matière financière et budgétaire.
C’est dans ce contexte qu’est fondé par la Banque Mondiale et le CNUEH (Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains), le programme Cities Alliance. Il consiste à mobiliser des fonds et à capitaliser l’expérience des acteurs locaux à travers deux axes. D’une part il s’agit d’aider les partenaires du Sud à définir un cadre de développement global au niveau d’une ville et de son hinterland, d’autre part il faut lutter contre la pauvreté urbaine pour améliorer les conditions de vie en ville. Ce programme s’adresse non seulement aux PED, mais également aux pays de l’ancien bloc soviétique. En outre, il propose une vision plus large du jeu d’acteurs et intègre les ONG.
La coopération urbaine française aujourd’hui
La mobilisation des grands bailleurs de fonds comme de la Banque Mondiale a largement influencé les stratégies de la coopération bilatérale.
Le secteur urbain occupe aujourd’hui une petite place dans le cadre du dispositif général de la coopération française. Le bureau du développement urbain du Ministère des Affaires Etrangères ne compte que 6 personnes, alors que 600 personnes travaillent dans l’ensemble de la DGCID (Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement). Le nombre d’assistants techniques pour le coopération urbaine est passé d’une centaine au milieu des années 90 à une soixantaine en 2003. La réforme de la coopération française de 1998 n’aura pas eu de véritable effet sur la stratégie de la coopération urbaine. Ses correspondants restent nombreux : la DAEI (Direction des Affaires Economiques et Internationales) et la DGUHC (Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction) dépendent du ministère de l’équipement ; le CNFPT (Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale) et la DGCL relèvent du ministère de l’intérieur en ce qui concerne la décentralisation ; l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) ; ou encore la DAPA (Direction de l’Architecture et du Patrimoine) au sein du ministère de la culture, etc… L’AFD (Agence Française de Développement) est quant à elle placée sous une triple tutelle : le ministère des finances, le ministère de affaires étrangères et celui des DOM-TOM. N’ayant pas de pilotage unique, les décisions prises manquent d’appui et de relais aux niveaux décisionnels des organisations internationales telles que l’Union Européenne et la Banque Mondiale. De fait, les activités de la France dans le secteur urbain à l’échelle internationale sont peu portées et mal connues.
Au regard de la multiplicité de ces acteurs se posent des problèmes de lisibilité des actions, chacun de ces organismes (pourtant publics) ayant sa propre stratégie.
Par ailleurs, le faible poids humain et financier de la coopération urbaine française, l’isole des autres coopérations bilatérales et la marginalise face aux bailleurs de fonds multilatéraux. Nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur s’accordent à souligner que le manque de lobbying des acteurs de la coopération urbaine française la condamne à suivre et à se soumettre aux orientations prises par la Banque Mondiale et par les organisations anglo-saxonnes, dont les stratégies résultent de réflexions et de discussions entre professionnels du monde entier desquelles les Français sont quasi absents. Finalement, les stratégies de la coopération s’avèrent dépendre des choix de ces bailleurs de fonds internationaux et en particulier de la Banque Mondiale.
Quelles carrières dans ce contexte ?
Voici dressé rapidement le contexte dans lequel la plupart des professionnels interrogés ont exercé leur métier au cours des quarante dernières années. Leurs témoignages montrent que leur vie professionnelle suit de près ces évolutions institutionnelles qui dictent l’aide au développement.
Les conditions d’exercice de ces professions ont incontestablement évolué au cours de ces décennies. Les mutations institutionnelles des bailleurs, les modalités de la croissance urbaine au sud, la professionnalisation d’agents locaux, la baisse de l’aide publique au développement, l’émergence des collectivités locales, la montée en puissance de la coopération décentralisée, l’apparition des ONG dans le secteur de l’urbain, sont autant d’éléments auxquels les professionnels intervenant dans le champ de la coopération urbaine ont dû et su progressivement s’adapter. Aux urbanistes, ingénieurs et architectes, sont venus progressivement se substituer les analystes financiers, les économistes, les spécialistes du foncier, les fiscalistes, les généralistes de la gestion urbaine, etc., impliquant de nouveaux types de missions : activités de conseil, de partenariat, de gestion, de diagnostic, d’assistance et d’évaluation.
Parallèlement, l’aide publique française qui s’était exclusivement consacrée à l’Afrique au lendemain de ses indépendances, a commencé à s’élargir géographiquement au cours des années 80. Ce qui a permis à nos professionnels de pratiquer aussi en Asie et en Amérique Latine.
Départs et retours
C’est en tant qu’assistant technique pour le compte du gouvernement français, en qualité de Volontaires du Service National (VSN), que bon nombre de professionnels ont débuté leur carrière. Ingénieurs, architectes et urbanistes étaient les principaux profils demandés dans le contexte de coopération de substitution. Nombreux sont ceux qui ont participé à l’élaboration des schémas directeurs et à la construction de logements jusqu’au milieu des années 70. Partis par goût et curiosité pour le voyage et l’expatriation, à la recherche d’expériences et de responsabilités, la plupart sont revenus en France après quelques années passées dans un pays en développement. Les retours coïncident avec la fin de leur contrat. Dans les années 60/70, les contrats d’une durée moyenne de 2 ans étaient renouvelés facilement. En revanche, lors de la période de la coopération par projet, la durée de vie des projets étant limitée, la fin des contrats correspondait à la fin du projet et ils n’avaient pas lieu d’être renouvelés. Par ailleurs, les financements de la coopération ont, progressivement, diminué entraînant la baisse des postes sur le terrain obligeant les coopérants à rentrer en France entre plusieurs missions. Avant sa dissolution au milieu des années 80, l’ACA (Agence Coopération et Aménagement) pouvait accueillir et rémunérer ces personnes pour des prestataires techniques dans le cadre des contrats dont elle disposait, ou pour des stages..
Le choix de retour provient parfois du sentiment d’être déconnecté du système français. Les perspectives sur le terrain n’ont plus le même sens après quelques années de coopération. Le besoin de se remettre à jour sur l’évolution des techniques et du système urbain français est fort, dans la mesure où les partenaires des pays en développement demandent aux professionnels, des références et des exemples de ce système.
Quelle que soit la raison d’un retour en France, les professionnels sont confrontés à un problème majeur : ils n’ont pas l’assurance de la continuité dans leur travail, d’autant qu’en fonction de leur âge, les incertitudes persistent lorsqu’il s’agit de se réorienter en milieu de carrière et qu’aucune structure n’est en charge de leur réinsertion.
Garder les liens personnels et professionnels
Ceci est d’autant plus vrai depuis la disparition de l’ACA, qui avait succédé au SMUH (Secrétariat des Missions d’Urbanisme et d’Habitat). Créé en 1960, le SMUH a joué un rôle fondamental dans le milieu du développement urbain tout d’abord en Afrique et dans les DOM-TOM, puis dans d’autres PED. Au départ, il servait simplement d’appui technique aux missions de la CCCE (actuellement l’AFD) puis il a élargi ses activités aux études urbaines, d’aménagement régional ou d’habitat, puis à la formation et à la documentation. Progressivement la création de stages spécialisés, destinés à des professionnels des pays en développement et de la France va permettre de constituer un réseau de professionnels cohérent dont le SMUH – ACA constituera longtemps le relais. Son centre de documentation, sa volonté pédagogique et sa présence en France, permettaient de garder des contacts avec l’international, de connaître les bureaux d’étude qui travaillaient dans ce domaine, d’échanger des expériences (voir même d’appliquer une doctrine et des techniques d’aménagement) et de maintenir ce réseau professionnel. A la dissolution de l’ACA, au milieu des années 80, les coopérants « urbains », dont une grande part était composée de contractuels, n’ont plus trouvé de lieu d’accueil entre deux affectations. Il n’existe plus de structure capable d’assurer aujourd’hui une continuité d’emploi pour les experts qui travaillent à l’export.
L’AdP, créée en 1979, garde toutefois en place la vie du réseau et du centre de documentation de l’ACA. Mais alors que le SMUH et l’ACA étaient subventionnés et bénéficiaient de contrats rémunérés, l’AdP ne fonctionne que grâce aux cotisations de ses adhérents individuels. Ce qui servait de base arrière unique pour la plupart des coopérants intervenant dans le développement urbain et qui constituait leur appui technique permanent n’a été remplacé que par des relations individuelles, transitant parfois par l’AdP.
Réintégration
La réintégration des professionnels de la coopération urbaine s’est effectuée inégalement selon les périodes. Des années 60 aux années 80, tandis que les fonctionnaires réintégraient la fonction publique, les coopérants du secteur privé pouvaient entrer dans des bureaux d’études importants ou s’installer comme experts indépendants. Aujourd’hui, les conditions de leur réintégration s’avèrent plus compliquées et exigeantes au regard de l’évolution et de la remise en question des pratiques et des fonctions de ces métiers.
Se réinsérer en France au cours de sa carrière signifie se remettre à jour en ce qui concerne l’environnement administratif et réglementaire de la ville et mais aussi réactiver ses réseaux personnels. C’est également le moment de faire le point sur ses compétences et ses aspirations, car l’expérience dans les pays en développement (pourtant riche en responsabilités et initiatives) est paradoxalement très dévalorisée en France. En ce sens, le souhait de revenir est assimilé au besoin de valoriser ses compétences et nombre d’experts choisissent, au milieu de leur carrière, de se réinsérer en France tout en essayant de garder la possibilité de faire des missions à l’international.
Or, les passerelles entre l’international et la France ne sont pas très nombreuses. De multiples démarches sont nécessaires. Il faut savoir faire jouer ses relations, avoir une grande flexibilité, être prêt à accepter des postes avec moins de responsabilités et faire preuve d’ouverture pour ne pas cesser de se documenter et de s’informer. Ecartelés entre leur position à l’étranger et le retour en France, autant que fragilisés par la non appartenance à un « corps » professionnel, leur assurant une perspective de carrière et au moins une garantie d’emploi à long terme, le soutien des expatriés partis sans être fonctionnaires (ces derniers étaient détachés pour quelques années et un poste les attendait à leur retour) n’est pas assuré.
Quelles offres, quelles opportunités ?
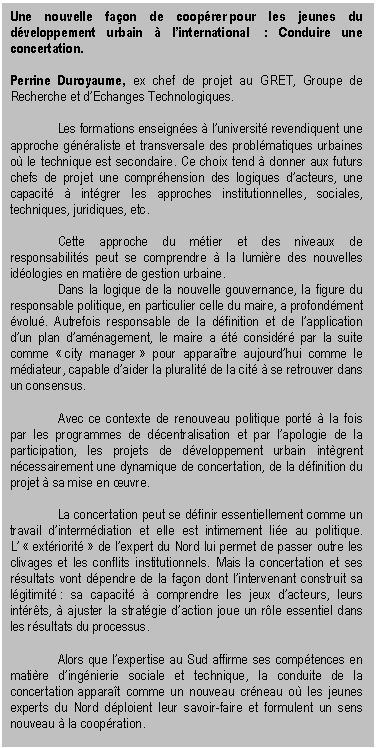
Face à ces transformations structurelles et contextuelles, il s’est agi, pour les expatriés de la coopération urbaine, de renouveler leurs approches à travers la remise en cause de leurs pratiques et parfois de leur métier. De retour en France, ils ont pu prendre le recul nécessaire sur leurs réalisations et penser de nouveaux modes d’action. D’une part, ils ont intégré la diversification des champs d’intervention et des compétences requis par le milieu à l’international, d’autre part, ils se sont adaptés à la multiplication des acteurs intervenant en ville, tels que les promoteurs, les entrepreneurs, les associations, les ONG, les collectivités locales, les milieux bancaire, économique et administratif, les bureaux d’étude privés, etc. La diversification et la multiplication des contenus ont élargi autant qu’elles ont brouillé la définition des métiers de la ville. En témoignent les formations nombreuses et variées qui orientent l’enseignement vers des problématiques émergeantes, tandis que les formations classiques proposent des options liées aux particularités urbaines des PED.
Actuellement, ce milieu professionnel se tourne de plus en plus vers l’expertise indépendante. Au milieu de leur carrière, les experts se sentent capables de travailler seuls, ou de s’associer grâce à leur réseau personnel en fonction des appels d’offre, de leur niveau de compétence et de leur savoir-faire spécialisé.
Certains, même s’ils sont toutefois moins nombreux, ont intégré des agences d’urbanismes ou les collectivités locales, mais aussi des entreprises immobilières et les très rares bureaux d’étude intervenant encore dans ce domaine. Ces structures sont attractives par la diversité des missions qu’elles peuvent proposer entre la France et l’étranger. Les places sont toutefois rares au sein de ce type de structure, où le contexte de travail est stable et les prises de risque professionnel moins importantes.
Ces choix témoignent des quelques alternatives possibles pour les personnes qualifiées. Les métiers de la fonction publique n’ont plus la même attractivité qu’il y a encore 15 ans, même si la voie des concours est encore une des solutions les plus fiables. Ce sont le milieu de l’expertise privée (bureaux d’étude et indépendants) ou encore les structures de coopération décentralisée (collectivités locales et agences d’urbanisme) qui majoritairement recrutent ces personnes de terrain. Les ONG, qui se tournent prioritairement vers des personnes en début de carrière, offrent quant à elles un cadre de travail de plus en plus recherché par les jeunes.
En parallèle, les professionnels interrogés ont fréquemment évoqué leur volonté de transmettre leur expérience, l’envie de participer à des programmes de formation professionnelle et technique au sein des ministères, ou d’enseigner dans une université, ou encore de prendre en charge un séminaire, mais aussi d’écrire. Cette activité, assez répandue chez ces professionnels, est rarement visible. Ces travaux leurs permettent de capitaliser les informations et d’abstraire la théorie de leurs travaux pratiques et opérationnels de terrain en synthétisant leur expérience et les nombreux documents qu’ils produisent.
Ainsi, la coopération urbaine française ne connaissait pas les problèmes actuels de l’intégration des jeunes professionnels. Pour autant, elle n’a commencé à s’ouvrir à d’autres champs géographiques, hors de l’Afrique francophone et particulièrement hors de la Côte d’Ivoire et de Madagascar, que tardivement. La zone de solidarité prioritaire (ZSP) qui définit actuellement les zones possibles d’intervention de la France s’étend à présent à presque toute l’Afrique mais aussi au proche Orient, à la péninsule indochinoise, aux Caraïbes, ….
Intégration des jeunes professionnels
La mondialisation bouleverse les cadres de l’intervention sur la ville et implique un renouvellement de l’expertise. L’inscription exclusivement nationale des processus urbains est remise en cause. Des logiques de marché, d’accès aux technologies, de compétition et de partenariats internationaux interfèrent plus fortement qu’avant sur les décisions locales. Aussi, les villes des pays en développement se compliquent elles considérablement tant d’un point de vue spatial que d’un point de vue économique et social. Ainsi, les questions qui se posent doivent être approchées non seulement à travers de nouveaux outils mais aussi à diverses échelles : agglomération, ville-centre, quartier et unité de voisinage.
Dans ce contexte, la montée en puissance des experts du Sud modifie les conditions d’exercice de la profession. Les bureaux d’études techniques des pays émergeants et des PED (Maroc, Liban, Tunisie, Egypte, Inde, etc.) ont une offre très compétitive dans le domaine urbain. Ils ont une meilleure pratique du terrain et connaissent parfaitement le milieu local, la société, les langues, etc. Ils proposent des tarifs plus intéressants, même s’ils sont de plus en plus nombreux à afficher des tarifs proches de ceux des bureaux d’études occidentaux. Souvent dotés d’équipes pluridisciplinaires dont le secteur de l’urbain est une des composantes, leurs champs d’actions restent très techniques (systèmes d’information géographique, logement, matériaux de construction, travaux publics, etc.). Les conditions des bailleurs de fonds dans le système de la coopération urbaine imposent la participation de ces BET dans les projets. De fait, le nombre de ces bureaux d’étude s’accroît considérablement, ce qui implique d’améliorer les connaissances sur les compétences locales afin de le valoriser et de créer des échanges entre les techniciens du Nord et ceux du Sud. Quoi qu’il en soit, les tâches se répartissent entre les différentes équipes et les partenariats s’améliorent. Il s’agit alors pour les professionnels du développement urbain de savoir renouveler leur approche face à la place grandissante des BET locaux afin de développer des partenariats de travail au lieu de tomber dans de simples logiques concurrentielles.
L’intégration des jeunes professionnels dans le cadre des actions de solidarité internationales d’urgence.
Eric Levron, responsable de projet, Groupe URD, Urgence-Réhabilitation-Développement.
Parmi les organisations non gouvernementales internationales disposant des moyens techniques et financiers les plus importants, les structures dédiées à la réponse aux urgences humanitaires sont sans conteste les plus puissantes. Cependant, en raison d’une tradition « ruraliste » solidement ancrée ou par crainte d’un certain nombre d’a priori aujourd’hui caducs, l’intervention humanitaire en ville est restée marginale. La spécificité de l’action d’urgence en milieu urbain n’est encore que peu, voire pas traduite formellement dans les orientations générales et les stratégies d’interventions des acteurs de l’urgence. Trop souvent, ces actions restent réactives, voire réalisées « par défaut » lorsque l’accès aux zones rurales est impossible. Quant aux interactions entre les milieux ruraux et urbains, elles restent totalement négligées.
Pourtant, les crises et les mouvements de populations qui en découlent touchent de plus en plus les zones urbaines. Les interventions en ex- Yougoslavie dans des milieux modernes et urbanisés ont marqué le début d’une remise en question que les humanitaires peinent toujours à faire aboutir. Que ce soit pour la reconstruction de Kaboul, l’aide à l’intégration des déplacés à Bogota ou de nombreuses autres villes touchées par les crises, il existe aujourd’hui une demande en expertise urbaine chez les acteurs humanitaires.
L’intégration de jeunes professionnels de l’urbain par le biais des acteurs de l’urgence peut donc constituer une « niche » intéressante. Les ONG d’urgence ont pour particularité d’être des structures composées essentiellement de jeunes où le turn over est extrêmement élevé : les possibilités d’y trouver un premier emploi y sont donc importantes si l’on cible les contextes sur lesquels on veut intervenir. Rapidement, des niveaux élevés de responsabilités en termes de gestion financière et humaine peuvent s’ouvrir aux personnes décidées à agir dans des milieux en turbulence, souvent loin du pré carré de la ZSP. Ce type d’expérience professionnelle souvent intense et enrichissante permet d’acquérir une légitimité sur la gestion de projet urbain. De plus, si le mode opératoire diffère du développement, les actions d’urgence reposent sur des mécanismes d’adaptation des populations qui sont assez semblables aux situations de pauvreté et d’exclusion urbaine dans les contextes stables. C’est dire combien les jeunes professionnels qui désirent faire leurs premiers pas dans l’action humanitaire d’urgence ont des outils et des connaissances qui peuvent être mis en valeur au service d’un secteur en quête de professionnalisation et de nouvelles expertises. Dans un marché de l’emploi difficile, ils ont en tout cas tout à y gagner…
Ce constat ouvre le débat sur l’évolution des modes de gestion de la ville et leur positionnement dans le contexte de coopération urbaine. D’une part, ce secteur n’est plus porté principalement par le gouvernement central et implique de plus en plus les nouveaux acteurs que sont les ONG et surtout les collectivités territoriales (Régions, Départements, Communes). Quelles que soient leur taille, leurs activités prioritaires, leur ancienneté, ces acteurs appuient leurs actions sur un savoir-faire acquis en France. De plus en plus, ces savoir-faire sont échangés avec des pays demandeurs de pratiques et d’outils des pays développés. D’autre part, les bureaux d’études locaux ayant acquis des compétences techniques, ONG et collectivités locales s’orientent vers un savoir-faire généraliste, qui consiste souvent à n’assurer que la coordination des projets ou un apport d’expertise pointue. Les filières d’économie, de finance, de gestion de projet, les métiers liés à la décentralisation et au fonctionnement des collectivités locales (formation d’élus locaux, transfert des compétences, aide au projet, apprentissage des procédures), les compétences recherchées en matières d’assistance institutionnelle et de gestion administrative, sont autant de savoir-faire sur lesquels ONG et collectivités basent leurs actions de coopération.
Par ailleurs, les qualités requises pour intervenir dans les villes en développement sont plurielles. Des qualités d’adaptation à de multiples contextes, des facilités de synthèse et d’écriture, des capacités d’assembleur, de coordonnateur, et de travail en équipes, la maîtrise des outils techniques, procéduriers et méthodologiques, semblent indispensables pour intégrer ce milieu professionnel. Ils illustrent particulièrement le caractère pluridisciplinaire et transversal de l’intervention en ville.
Pour autant, les possibilités de mener une carrière professionnelle uniquement à l’international semblent compromises. Aujourd’hui, la durée des missions diminue nettement et les interventions de la coopération se fondent de plus en plus sur l’échange de savoir-faire. L’expérience de tous montre l’efficacité des allers et retours entre la France et les pays en développement en termes de compétences. L’alternance des missions permet de stimuler les connaissances et l’échange. De nombreuses collectivités ou encore quelques agences d’urbanisme françaises, celles de Lyon et de Paris particulièrement, l’IAURIF, (Institut l’Aménagement Urbanisme de la Région Ile-de-France), etc. travaillent sur des projets à l’étranger. Ces acteurs du développement urbain en France proposent à leurs salariés des missions ponctuelles dans les PED en fonction de leurs compétences, de leurs disponibilités, etc. Disposant d’un vivier de professionnels spécialisés sur les problématiques urbaines, elles ont une vraie légitimité à intervenir à l’international dans le cadre de missions d’appui conseil et de formation autant que d’échange et d’expertise. Ces structures font parfois appel à des intervenants extérieurs quand elles ne disposent pas en interne des compétences spécifiques requises pour un projet.
Dans ce cadre, les carrières en aller et retour paraissent tant possibles que dynamisantes. Mais bien plus, elles sont vivement recommandées par les professionnels interrogés qui s’accordent à souligner leur caractère enrichissant et la valorisation des expériences et des savoir-faire dans un sens comme dans l’autre.

